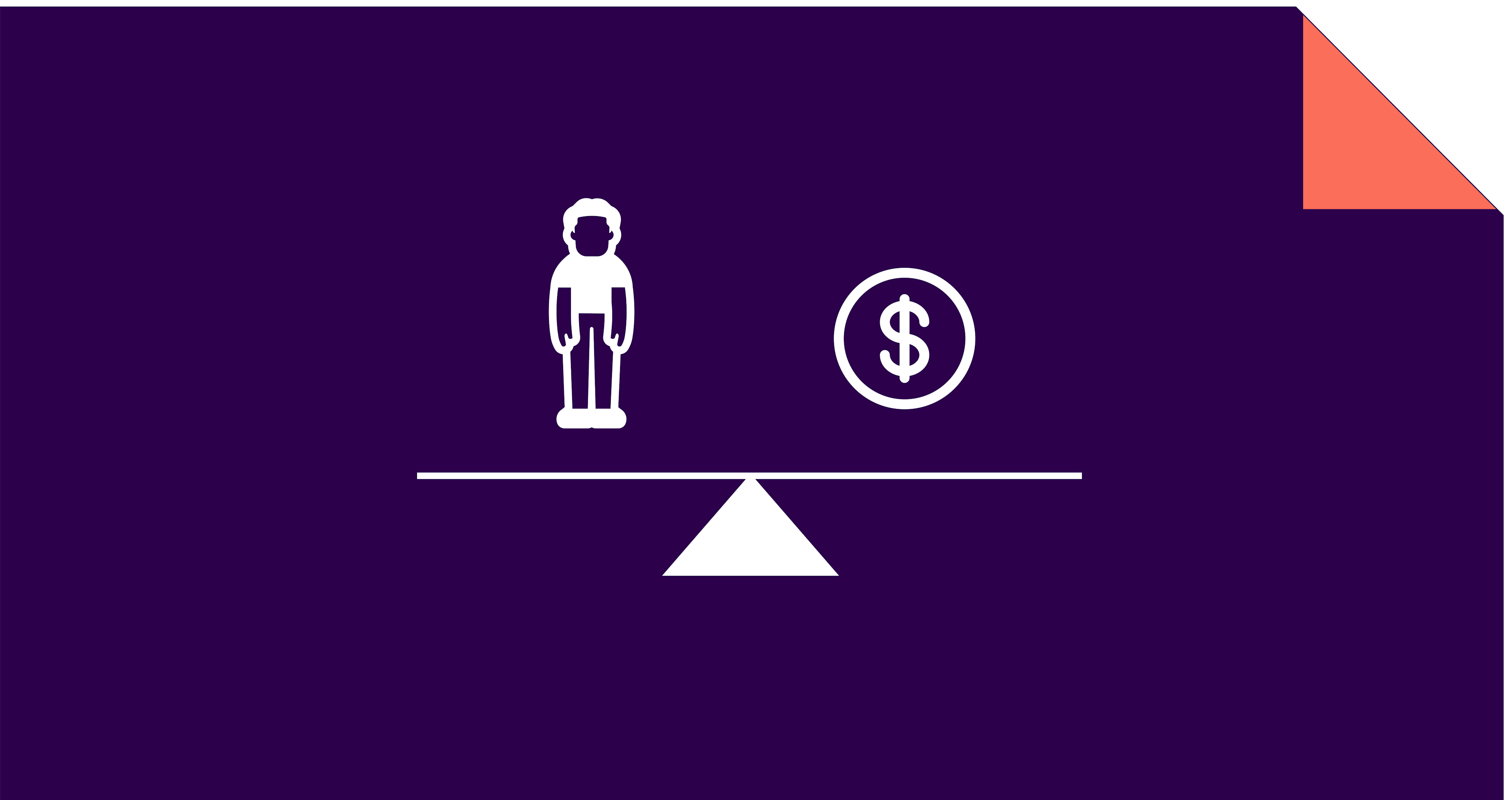
Abus de dépendance économique : le guide complet (2025)
Abus de dépendance économique : définition, risques et prévention (2025)
Dans les échanges entre directions juridiques, équipes achats et directions générales, les termes « dépendance économique » et « abus de dépendance économique » sont parfois confondus, comme s'ils désignaient un même risque juridique.
En réalité, la dépendance économique constitue une situation commerciale fréquente et parfaitement légale, tandis que « l’abus » relève du droit de la concurrence et peut entraîner des sanctions allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial du donneur d’ordre. Chez Provigis, nous constatons régulièrement cette confusion :
- Des donneurs d'ordre nous demandent comment « éviter la dépendance économique » de leurs fournisseurs, alors qu'ils s'inquiètent en réalité du risque d'abus ;
- Certains clients pensent que toute relation privilégiée avec un fournisseur expose automatiquement à des sanctions, sans distinguer dépendance et exploitation abusive ;
- D'autres enfin négligent la surveillance de leurs partenaires vulnérables et ignorent que cette vigilance constitue leur meilleure défense juridique.
La rédaction de Provigis a donc élaboré ce guide pour clarifier ces notions avec des critères exhaustifs, des exemples jurisprudentiels récents, 7 bonnes pratiques de prévention et une analyse des risques tant pour le fournisseur dépendant que pour l'entreprise dominante.
Qu'est-ce que la « dépendance économique » ?
La dépendance économique se définit comme la concentration d'une part importante du chiffre d'affaires d'une entreprise sur une minorité de clients, voire un seul partenaire commercial. Cette situation place l'entreprise dans une relation commerciale déséquilibrée, où sa survie économique dépend étroitement des décisions de son principal partenaire.
Cette définition théorique doit évidemment être complétée par la jurisprudence française : « la dépendance économique désigne l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise » (Com. 12 févr. 2013, n° 12-13.603).
Cette impossibilité de substitution constitue le cœur de la notion : l'entreprise dépendante ne peut pas simplement changer de partenaire sans mettre en péril son activité. Concrètement, cette dépendance se traduit par une adaptation progressive de l'entreprise aux besoins (très) spécifiques de son client principal :
- Processus de production dédiés ;
- Investissements dans des équipements spécialisés ;
- Développement de compétences sur-mesure, etc.
Plus la relation commerciale se prolonge, plus l'entreprise se spécialise pour répondre aux exigences de son partenaire dominant, ce qui rend difficile, voire impossible (économiquement parlant) la reconversion vers d'autres clients.
💡 La dépendance économique, un phénomène sectoriel
La dépendance économique est une réalité commerciale très fréquente dans le tissu économique français, notamment dans les secteurs de la sous-traitance industrielle, du transport, de la distribution et des services aux entreprises.
La dépendance économique est-elle illégale en France ?
La dépendance économique constitue avant tout une vulnérabilité d'ordre gestionnaire et stratégique. C'est une réalité commerciale qui relève du domaine de la gestion d'entreprise et du pilotage des risques.
De nombreuses PME et ETI françaises fonctionnent en situation de dépendance économique et réalisent parfois 50 %, 70 % voire 90 % de leur chiffre d'affaires avec un client unique. Cette concentration est certes risquée pour la pérennité de l’entreprise, mais elle reste parfaitement légale. Elle peut parfois s'avérer économiquement viable, voire avantageuse dans certains secteurs pour plusieurs raisons :
- Une grande visibilité sur les commandes ;
- Une relation de confiance établie ;
- Des investissements très ciblés, dont le ROI est quasiment garanti ;
- Un transfert de savoir-faire qui permet au fournisseur de gagner en compétence et en expertise…
💡 La dépendance économique, un phénomène sectoriel
Dans l'automobile ou l'aéronautique, des sous-traitants prospèrent depuis des décennies en travaillant quasi-exclusivement pour un constructeur. Figeac Aéro, par exemple, réalise plus de la moitié de son activité avec Airbus (selon France Bleu). Ce type de relation de dépendance structure des pans entiers de l'industrie française.
Ce qui est illégal, en revanche, c'est l'abus de cette dépendance économique. L'article L. 420-2 du Code de commerce interdit explicitement « l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». La nuance est ici fondamentale : la loi ne sanctionne pas la dépendance elle-même, mais son exploitation abusive par le partenaire dominant.
L'abus peut prendre plusieurs formes :
- Imposition de conditions commerciales déraisonnables ;
- Modification unilatérale et brutale des termes du contrat ;
- Pratiques tarifaires qui « écrasent » les marges du partenaire dépendant ;
- Rupture sans préavis (ou sans préavis suffisant, etc.).
Ces comportements sont sanctionnés car ils tirent profit de la vulnérabilité du partenaire qui, faute d'alternative, se trouve contraint d'accepter des conditions qu'il refuserait dans un rapport commercial équilibré.
💡 Relation commerciale privilégiée ou abus de dépendance ?
La frontière entre gestion normale d'une relation commerciale privilégiée et abus de dépendance économique reste toutefois délicate à tracer. C'est pourquoi l'Autorité de la concurrence et les tribunaux examinent chaque situation au cas par cas, en tenant compte du contexte économique, de l'historique de la relation et du comportement des deux parties. L'entreprise dominante doit donc faire preuve de vigilance et documenter ses pratiques commerciales pour éviter toute accusation d'abus.
Abus de dépendance économique vs. notions juridiques proches
#1 Abus de dépendance économique vs. abus de position dominante
L'abus de dépendance économique et l'abus de position dominante constituent deux infractions différentes dans le droit de la concurrence, bien qu'elles puissent parfois se chevaucher. Leurs différences portent sur les conditions d'application, les critères de caractérisation et les effets recherchés.
L'abus de position dominante, prévu par l'article L. 420-2 alinéa 1 du Code de commerce, sanctionne l'exploitation abusive d'une position dominante sur un marché. Cette infraction exige la démonstration d'une domination objective sur un marché pertinent, généralement caractérisée par des parts de marché importantes (présomption au-delà de 50 %) et la capacité de s'affranchir des pressions concurrentielles. L'analyse porte sur la structure du marché et la position de l'entreprise vis-à-vis de l'ensemble de ses concurrents.
L'abus de dépendance économique sanctionne quant à lui l'exploitation d'une relation bilatérale déséquilibrée sans exiger de position dominante au sens classique. Il suffit qu'une entreprise exploite la vulnérabilité d'un partenaire commercial, même si elle ne domine pas le marché dans son ensemble. Cette infraction s'inscrit dans une logique de protection des relations commerciales déséquilibrées plutôt que de régulation de la structure des marchés.
Les effets anticoncurrentiels recherchés sont différents dans ces deux infractions :
- L’infraction d'abus de position dominante vise à protéger le processus concurrentiel dans son ensemble ;
- L’infraction d'abus de dépendance économique protège les entreprises « dominées » contre l'exploitation d’un rapport de force structurellement déséquilibré avec leur donneur d’ordre.
💡 À savoir
L'abus de dépendance économique constitue une particularité de certains droits nationaux et n’a pas d’équivalent en droit de la concurrence de l'Union européenne. Il a été intégré en droit français par l'ordonnance du 1er décembre 1986 en suivant le modèle allemand, tandis que le droit européen privilégie d'autres approches comme les règlements sectoriels, par exemple sur le numérique et l'agroalimentaire.
#2 Abus de dépendance économique vs. rupture brutale de relations commerciales établies
La rupture brutale de relations commerciales établies, régie par l'article L. 442-1, II du Code de commerce, exige seulement l'existence d'une relation commerciale établie et l'absence de préavis écrit suffisant. Aucune démonstration d'affectation de la concurrence n'est requise, contrairement à l'abus de dépendance économique qui impose cette condition pour être qualifié et sanctionné.
L'objectif diffère également : la rupture brutale protège l'entreprise individuelle victime en lui laissant le temps de se réorganiser, tandis que l'abus de dépendance économique vise à préserver le fonctionnement concurrentiel du marché dans son ensemble.
Concernant le régime de sanctions, ce sont les juridictions civiles spécialisées qui statuent dans la rupture brutale, tandis que l'Autorité de la concurrence prononce les sanctions administratives liées à l'abus de dépendance économique. Les dommages-intérêts en cas de rupture brutale correspondent à la marge brute non réalisée pendant le préavis manquant, tandis que l'abus de dépendance économique peut entraîner des amendes jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial.
Depuis 2019, un préavis de 18 mois exonère automatiquement l'auteur d'une rupture de sa responsabilité, quelle que soit la durée de la relation. Cette protection temporelle n'existe pas pour l'abus de dépendance économique.
💡 Deux infractions qui peuvent se compléter
Dans la pratique, les deux fondements juridiques se complètent : la dépendance économique constitue un critère d'appréciation de la durée du préavis nécessaire en cas de rupture brutale. Les entreprises invoquent souvent les deux fondements de manière cumulative, la rupture brutale étant plus facilement sanctionnée que l'abus de dépendance économique en raison de conditions moins restrictives.
Comment reconnaître une situation de dépendance économique ?
La dépendance économique peut apparaître progressivement, à mesure que la concentration du chiffre d’affaires s’accentue et que les alternatives commerciales se réduisent. Mais elle peut également surgir brutalement, dès la signature d’un contrat ou en quelques semaines, notamment dans les cas suivants :
- Perte soudaine de plusieurs clients, une situation qui ne laisse qu’un seul ou une poignée de donneur(s) d’ordre actif(s) ;
- Signature d’un contrat d’exclusivité avec un grand client ;
- Investissement massif fléché vers un seul client (outil de production, logiciel, certification…) ;
- Opérations de fusions ou de rachats sur le marché qui réduisent les débouchés disponibles (ou le marché total adressable).
Critère #1 : le poids du chiffre d’affaires
Le premier indicateur est la part du chiffre d’affaires réalisée avec le client. Selon la jurisprudence, un risque de dépendance commence à se poser lorsque cette part dépasse 20 à 25 %. Dans les cas effectivement reconnus comme des situations de dépendance économique, la concentration dépasse souvent 50 %, voire 60 % du chiffre d’affaires global. Ce taux n’est jamais suffisant à lui seul. Il doit être interprété à la lumière des autres critères : existence d’alternatives, équilibre contractuel, efforts de diversification, etc.
Critère #2 : l’absence d’alternative économiquement équivalente
C’est le critère central : la dépendance ne se limite pas à une forte concentration du chiffre d’affaires. Elle implique surtout l’impossibilité de trouver d’autres clients ou partenaires susceptibles d’assurer la continuité de l’activité dans des conditions économiques et techniques similaires. Cette impossibilité peut résulter :
- d’un marché fermé ou très concentré ;
- d’une spécialisation technique poussée vers un seul client ;
- d’investissements non transférables à d’autres partenaires.
La dépendance se mesure donc à l’absence concrète de solution de remplacement réaliste.
Critère #3 : des conditions contractuelles déséquilibrées
Un contrat déséquilibré peut être un signal d’alerte. Clauses de révision tarifaire unilatérale, délais de paiement inhabituels, pénalités excessives, absence d’engagement sur les volumes : autant d’éléments qui traduisent un rapport de force défavorable.
Là encore, ces déséquilibres contractuels ne suffisent pas, à eux seuls, à établir une dépendance économique. Ils peuvent toutefois renforcer d’autres indices objectifs.
Critère #4 : l’impossibilité structurelle de diversification
Lorsqu’un fournisseur déploie l’essentiel de ses moyens techniques, humains ou commerciaux au service d’un client unique, il devient difficile de réallouer ces ressources à d’autres acteurs du marché. Ce quatrième critère est la conséquence du deuxième.
Cette situation peut être aggravée par :
- des clauses d’exclusivité, même partielles ;
- une réputation de prestataire « captif » ;
- des contraintes sectorielles particulières (homologations, certifications, outils spécialisés…).
⚠️ Attention
Ce critère n’est retenu que si l’entreprise a effectivement tenté de se diversifier. Si la concentration sur un seul client résulte davantage d’un choix de gestion ou d’une absence d’effort commercial, la dépendance ne sera probablement pas reconnue.
Quels sont les risques de la dépendance économique pour le fournisseur/prestataire ?
La relation de dépendance économique modifie en profondeur le fonctionnement de l’entreprise concernée. Ce n’est plus elle qui choisit ses conditions de travail, son rythme de croissance, sa stratégie et ses priorités d’investissement : c’est son client principal.
#1 Rupture brutale du contrat ou baisse soudaine de commandes
Le risque le plus immédiat, et potentiellement le plus destructeur, reste la rupture brutale ou la réduction marquée des volumes commandés par le client dominant. Lorsqu’une entreprise dépend fortement d’un seul donneur d’ordre, elle n’a ni marge de manœuvre, ni filet de sécurité pour absorber un choc commercial.
Cette rupture peut être :
- Volontaire (apparition d’un fournisseur plus compétitif, internalisation, changement de stratégie, délocalisation…) ;
- Conjoncturelle (ralentissement économique, crise sanitaire, baisse de consommation…) ;
- Juridique (résiliation pour manquement, fin de contrat sans renouvellement…).
La violence de l’impact dépend évidemment du niveau de dépendance, mais aussi de la capacité à réagir. Une entreprise qui réalise 70 % de son chiffre d’affaires avec un seul client et qui perd ce contrat du jour au lendemain peut se retrouver en situation de cessation de paiement en quelques mois, voire quelques semaines, faute de carnet de commandes de substitution.
Même si la loi interdit la rupture brutale de relations commerciales établies sans préavis suffisant (article L. 442-1, II du Code de commerce), l’application de ce texte n’empêche pas les conséquences économiques immédiates : désorganisation, sous-activité, licenciements, perte de trésorerie…
⚠️ Attention
Dans la majorité des cas, aucun mécanisme de protection n’a été prévu (ni préavis contractuel, ni engagement de volume), car l’entreprise dépendante n’est pas en position de l’exiger au moment de la négociation.
#2 Pression unilatérale sur les prix ou les délais
Lorsque le client sait qu’il détient un poids déterminant dans l’activité de son fournisseur, il peut en profiter pour imposer des conditions économiques de plus en plus défavorables. Cela peut se traduire par :
- des baisses tarifaires imposées sans contrepartie claire ;
- des délais de paiement allongés au-delà des standards contractuels ou légaux ;
- des demandes de livraison plus rapides sans adaptation des ressources ;
- de nouvelles exigences en matière de service après-vente, sans rémunération complémentaire.
Dans ce type de relation déséquilibrée, le fournisseur n’a pas la capacité de refuser frontalement sans risquer la perte du contrat. Il accepte alors, par contrainte commerciale, des conditions qui fragilisent sa marge, son organisation et sa trésorerie.
Ce phénomène est d’autant plus courant que la relation dure : plus le fournisseur s’est adapté à son client (outils, certifications, recrutement, process…), plus il devient captif, donc négociateur faible.
#3 Difficulté à planifier les investissements productifs à moyen terme
Un fournisseur économiquement dépendant ne peut pas planifier sereinement ses investissements, même lorsque la relation commerciale semble stable. L’incertitude permanente sur la reconduction du contrat, sur les volumes commandés ou sur les conditions tarifaires bloque toute projection à moyen terme.
Cette instabilité fragilise davantage la position de l’entreprise « dominée » :
- les projets de développement sont bridés, voire tout simplement absents, faute de visibilité sur la situation de l’entreprise ;
- l’entreprise évite généralement de recruter en CDI, de peur d’un retournement soudain ;
- les demandes de financement sont plus difficiles à défendre auprès des banques, qui identifient un risque de dépendance dans l’analyse du dossier.
💡 Le cercle vicieux de la dépendance économique
La structure productive reste figée, sous-dimensionnée ou vétuste, ce qui limite les gains de compétitivité. Le fournisseur entre alors dans un cercle vicieux où son incapacité à investir nourrit sa situation de dépendance économique.
#4 Positionnement trop étroit pour attirer d’autres clients
À mesure que la relation avec le client principal se renforce, le fournisseur adapte son fonctionnement pour répondre à ses exigences. Cette spécialisation progressive entraîne un rétrécissement du positionnement commercial de l’entreprise. Ainsi :
- L’offre devient difficilement transposable à d’autres clients ;
- Le fournisseur est perçu comme un prestataire « captif », peu disponible ou peu pertinent pour d’autres donneurs d’ordre.
Dans les faits, cette spécialisation pousse les prospects à se détourner, soit parce qu’ils craignent un manque de réactivité, soit parce qu’ils considèrent que le fournisseur est déjà « verrouillé » par un acteur concurrent.
Cette situation renforce l’isolement commercial du fournisseur qui se retrouve piégé dans un positionnement étroit, incompatible avec une stratégie de diversification.
Quels sont les risques de la dépendance économique pour l’entreprise cliente (dominante) ?
La dépendance économique n’expose pas uniquement le fournisseur. Le donneur d’ordre lui-même prend des risques lorsqu’il laisse s’installer une relation déséquilibrée : risque juridique en cas d’abus, risque opérationnel si le partenaire flanche, risque réputationnel si la rupture est mal perçue, etc. Dans tous les cas, c’est sa position dominante qui sera scrutée.
Et c’est sa capacité à démontrer une vigilance active, constante et documentée qui permettra de déterminer s’il est en tort.
#1 Risque juridique en cas d’abus de dépendance économique
Lorsqu’un client impose des conditions commerciales particulièrement défavorables à un fournisseur qui dépend fortement de lui, il s’expose à une action fondée sur l’abus de dépendance économique (article L. 420-2 du Code de commerce).
Trois éléments sont alors requis pour engager la responsabilité de l’entreprise dominante :
- Un état de dépendance avéré du fournisseur (part prépondérante du chiffre d’affaires, absence d’alternative équivalente…) ;
- Un comportement abusif (pression tarifaire, rupture brutale, modification unilatérale du contrat…) ;
- Un effet réel ou prévisible sur le fonctionnement normal du marché, par exemple si la disparition du fournisseur réduit l’offre ou renforce artificiellement la position du dominant.
Bien qu’exceptionnelle, cette infraction a déjà été reconnue en France. Dans sa décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, l’Autorité de la concurrence a condamné Apple pour abus de dépendance économique envers ses revendeurs premium (Apple Premium Reseller). La Cour d’appel de Paris a confirmé ce point en 2022, rappelant que le rapport de force dans une relation bilatérale suffit, même sans position dominante au sens strict.
💡 À savoir
Le grief ne porte pas sur la dépendance elle-même, mais sur son exploitation. Le donneur d’ordre doit pouvoir démontrer que ses décisions commerciales restent loyales, justifiées et adaptées à la situation économique du partenaire.
#2 Risque opérationnel en cas de défaillance du fournisseur dépendant
La dépendance économique est rarement réciproque. Dans la majorité des cas, le fournisseur structure son activité autour d’un client de type « grand compte », tandis que ce dernier conserve sa liberté de sourcing.
Si le fournisseur flanche, le client s’adapte : il active ou réactive un autre partenaire, ajuste ses volumes, envisage l’internalisation de la production, etc.
Mais certains secteurs ou contextes créent une exposition inverse : le client devient, lui aussi, vulnérable à la moindre défaillance du fournisseur, sans pour autant être dépendant au sens juridique. Quelques exemples :
- Le fournisseur a développé une compétence difficile à transférer (pièce technique, savoir-faire, logiciel propriétaire, expérience, vitesse d’exécution…) ;
- Il accorde des conditions commerciales très avantageuses, que ce soit en termes de prix, de délais de paiement ou de livraison, etc. Ces conditions sont difficiles à trouver ailleurs ;
- Le client n’a jamais mis en place de plan de continuité (second fournisseur qualifié, stock de sécurité, documentation technique...) ;
- Le changement de partenaire serait trop coûteux ou trop chronophage, surtout si l’entreprise « dominante » doit honorer des commandes auprès de ses propres clients.
#3 Risque réputationnel en cas de perception d’abus
Un donneur d’ordre peut parfaitement respecter ses obligations contractuelles et se retrouver publiquement accusé d’avoir fragilisé un partenaire plus petit. Il suffit parfois d’une rupture sèche, d’un redressement judiciaire du fournisseur ou d’un message relayé sur LinkedIn pour que l’entreprise dominante soit perçue comme « abusive ».
Ce basculement d’image n’a pas besoin de fondement juridique pour produire ses effets. Il repose sur un déséquilibre évident : un grand groupe face à une PME ou TPE dépendante, un contrat non renouvelé, un fournisseur qui disparaît du jour au lendemain, etc.
Le récit se construit sans procès, sans décision de justice, mais avec un impact immédiat sur la réputation du client.
Ce risque est renforcé lorsque le donneur d’ordre travaille avec des partenaires visibles (fournisseurs locaux, acteurs spécialisés, prestataires historiques), ou dans des secteurs scrutés (numérique, textile, agroalimentaire, tech industrielle…).
Donneurs d’ordre : comment limiter les risques liés à la dépendance économique ?
La prévention de l'abus de dépendance économique repose sur un paradoxe : l'entreprise dominante doit limiter l'exploitation de sa position de force… pour la préserver ! En d’autres termes, elle doit renoncer à certains avantages qu'elle pourrait techniquement imposer à son fournisseur « captif » pour éviter les sanctions de l'Autorité de la concurrence (jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial) et sécuriser la continuité d'approvisionnement.
Le risque juridique s’accompagne en effet de vulnérabilités opérationnelles, car un fournisseur fragilisé par une dépendance excessive devient un maillon fragile de la chaîne de valeur. Sa disparition brutale peut paralyser la production du donneur d'ordre, créer des ruptures de stock et contraindre à des relocalisations d'urgence particulièrement coûteuses.
La gestion préventive de ces situations nécessite une approche à double détente :
- Anticiper les effets de ses propres exigences sur les partenaires ;
- Surveiller activement leur santé économique.
Cette vigilance, qui doit être dûment documentée, constitue la meilleure défense en cas d'accusation d'abus de dépendance économique. Voici 7 bonnes pratiques à déployer.
#1 Anticiper les effets d’un partenariat potentiellement captif
Dès les premiers échanges, certains choix qui encadrent la relation commerciale peuvent favoriser l’apparition d’une situation de dépendance économique : part dominante dans le chiffre d’affaires, effort technique non réutilisable, absence de débouchés alternatifs, ajustement progressif des équipes ou des outils à un seul client, etc.
Le donneur d’ordre doit mesurer les effets à moyen terme de ses propres exigences. Demander des investissements dédiés, conditionner le référencement du fournisseur à une montée en charge rapide, imposer des délais courts ou une exclusivité sectorielle, c’est mettre dès le départ la relation dans les rails de la dépendance économique.
Ce verrouillage peut devenir problématique si la relation se tend avec un changement de direction, une baisse de volume, une délocalisation… Et si la rupture survient dans une configuration houleuse, la responsabilité du donneur d’ordre peut être engagée.
#2 Formaliser les contreparties à toute exigence technique ou financière
Lorsqu’un donneur d’ordre demande à son fournisseur un effort ciblé, comme par exemple un investissement matériel, des embauches en CDI, l’obtention d’une certification métier ou encore l’implémentation d’une solution logicielle, cet effort doit être encadré par des engagements contractuels. Sans cela, la relation glisse vers un déséquilibre juridique difficile à défendre.
Ce type d’exigence peut en effet structurer toute l’activité du fournisseur pendant plusieurs années (par opposition à un simple ajustement ponctuel comme de l’intérim, un CDD, une location…). L’entreprise cliente doit l’assumer en inscrivant noir sur blanc tout ou partie des éléments suivants :
- La durée prévisible de la relation, à minima sur les prestations en rapport avec l’effort demandé ;
- Les volumes minimums garantis ;
- Les conditions de rémunération ou de participation aux frais ;
- Les conséquences en cas d’arrêt anticipé.
L’idée est d’éviter les zones grises sujettes à interprétation dans le contrat pour protéger les deux parties. En l’absence de contrepartie, la démarche pourra être requalifiée en abus de dépendance économique si le fournisseur démontre qu’il n’a eu d’autre choix que d’accepter ces conditions pour préserver son activité et la pérennité de son entreprise.
💡 Exemples de clauses pour encadrer un effort demandé au fournisseur
Dans l’aéronautique, l’automobile, la pharmacie ou l’électronique embarquée, les contrats de sous-traitance prévoient souvent des mécanismes d’équilibrage lorsque le client impose un outillage, une ligne dédiée ou une montée en compétence orientée vers un seul besoin.
Plusieurs leviers contractuels permettent alors de répartir la charge : échéancier d’achats pluriannuel, clause d’amortissement, grille de compensation en cas de rupture anticipée, volumes progressifs, droit de priorité sur les futurs appels d’offres, ou exclusivité temporaire sur un segment défini.
Ces clauses permettent au client de sécuriser l’exécution du projet tout en réduisant le risque qu’un fournisseur devenu captif le poursuive pour abus de dépendance économique s’il décidait de s’en séparer.
#3 Prévoir une clause de sortie dès le démarrage de la relation
Quand le client met fin à la relation, le fournisseur découvre souvent qu’aucune règle de sortie n’a été posée au départ : aucun délai n’est prévu, aucun volume n’est garanti, aucune procédure n’encadre le retrait des outils, des accès ou des données, etc. Cette impréparation crée des tensions, des pertes sèches et parfois un litige. Elle fragilise le fournisseur, mais elle expose aussi le donneur d’ordre si la rupture intervient dans un contexte de dépendance économique.
C’est pourquoi il faut impérativement prévoir une clause de sortie qui verrouille ce moment. Elle fixera les délais, l’échéancier d’arrêt, les conditions de transfert ou de remboursement s’il y a eu cofinancement et les droits d’usage sur les éléments développés.
Ce cadre protège le fournisseur contre une rupture brutale, et le client contre une requalification en abus si la dépendance économique est manifeste au moment du retrait.
#4 Documenter et justifier toutes les décisions commerciales
Chaque modification tarifaire, ajustement contractuel ou décision stratégique qui concerne le fournisseur en situation de dépendance économique doit faire l'objet d'une traçabilité écrite. Cette documentation permet de démontrer que les conditions imposées résultent de contraintes économiques objectives et non d'un abus de position.
La justification doit porter sur des éléments factuels : évolution des coûts, changements réglementaires, ajustements de marché, contraintes techniques ou logistiques, etc. L'entreprise dominante évite ainsi les accusations d’abus si la relation se tend ou si le fournisseur conteste les nouvelles conditions.
Cette traçabilité couvre également les communications internes relatives à ce partenaire. Les échanges entre équipes « Achat », direction commerciale ou management général doivent éviter les formulations qui pourraient être interprétées comme la reconnaissance d'un rapport de force abusif. Un mail interne évoquant la « pression » exercée sur un fournisseur « captif » peut devenir problématique en cas de litige.
💡 La documentation, un vecteur de rationalisation
La documentation structure enfin la prise de décision elle-même. Elle oblige les équipes à formaliser leur raisonnement, à vérifier la proportionnalité des mesures et à anticiper les conséquences pour le partenaire dépendant.
#5 Éviter un verrouillage opérationnel ou juridique du fournisseur
Le donneur d’ordre peut créer une situation de dépendance économique de fait si ses exigences bloquent matériellement toute prospection du fournisseur :
- Planning saturé par les commandes ;
- Engagement de réactivité incompatible avec un autre client (ex. : astreinte, délai de livraison contractuel ultra-court) ;
- Outillage ou développement très personnalisé, et donc non mutualisable ;
- Pression ou dissuasion « en off » contre la prospection ou la candidature à des appels d’offres.
Si le partenariat s’interrompt, le fournisseur n’a aucun relais. Et si un contentieux survient, cette dépendance peut être démontrée par la nature des obligations imposées. Le donneur d’ordre peut limiter ce risque en déverrouillant certaines pratiques à effet captateur, sans renoncer à la qualité de la relation. Il peut, par exemple :
- Retirer une clause d’exclusivité non exploitée, par exemple sectorielle ou territoriale, devenue inutile dans le cadre du projet ;
- Ne pas s’opposer à la participation du fournisseur à des appels d’offres hors périmètre ;
- Adapter les clauses de disponibilité ou les obligations de service, notamment sur les temps de réponse ou les plages horaires couvertes lorsqu’elles empêchent tout autre engagement professionnel.
Ces ajustements n’ont pas vocation à affaiblir le contrat. Ils visent à prouver que le client n’a pas enfermé son fournisseur dans une exclusivité de fait, et que la relation n’a pas été construite pour rendre toute diversification impossible. Cette posture est défendable dans un cadre juridique, présentable dans un audit et utile en cas de défaillance du partenaire.
#6 Surveiller la santé financière et la diversification du fournisseur
Le donneur d'ordre doit mettre en place un dispositif de surveillance pour détecter l'évolution de la dépendance économique de ses fournisseurs et anticiper leurs difficultés financières. Cette veille constitue une protection juridique contre les accusations d'abus et une couverture opérationnelle contre les risques de rupture d'approvisionnement.
Le suivi porte d'abord sur les indicateurs de dépendance :
- Part du chiffre d'affaires réalisée avec le donneur d'ordre ;
- Nombre de clients actifs ;
- Capacité de diversification, etc.
Quand un fournisseur dépasse 50 % de concentration sur un seul client ou perd progressivement ses autres débouchés, la relation bascule dans une zone juridiquement sensible. Imposer de nouvelles contraintes tarifaires ou techniques à un partenaire déjà fragilisé peut alors constituer une exploitation abusive de sa vulnérabilité.
La surveillance financière permet également d'identifier les signaux d’alerte :
- Retards dans les déclarations fiscales ;
- Difficultés de paiement URSSAF ;
- Dégradation des ratios du bilan ;
- Retard dans le paiement des fournisseurs, etc.
Ces éléments révèlent une entreprise sous tension qui risque la défaillance, avec un double risque pour le donneur d'ordre : le risque juridique, par l’accusation d'avoir contribué à la fragilisation d’un fournisseur par abus de dépendance économique, et le risque opérationnel par la rupture de la chaîne d’approvisionnement.
💡 Provigis vous aide à structurer cette veille
En tant que Tiers de Collecte Probatoire (TCP), Provigis permet de structurer cette surveillance en centralisant plus de 50 types de documents (KBIS, attestations URSSAF, bilans financiers, certifications, assurances) et en déclenchant des alertes d'expiration ou de non-conformité. Cette automatisation garantit une veille objective et documentée, indispensable pour démontrer la diligence du donneur d'ordre en cas de contentieux.
#7 Former les équipes achats aux risques juridiques
Les équipes « Achat » constituent le premier rempart contre les accusations d'abus de dépendance économique. Elles négocient les contrats, fixent les conditions tarifaires et gèrent au quotidien les relations avec les fournisseurs vulnérables. Leur formation aux enjeux juridiques de la dépendance économique est donc indispensable pour prévenir les dérives.
La formation doit porter sur les critères de reconnaissance d'une situation de dépendance :
- Les seuils de concentration du chiffre d'affaires ;
- La jurisprudence française en la matière (voir partie suivante) ;
- L’absence d'alternatives économiquement équivalentes pour le fournisseur ;
- Les investissements trop « personnalisés » au client ;
- Les conditions contractuelles susceptibles d’être qualifiées de « déséquilibrées » par le législateur, etc.
Les acheteurs doivent savoir identifier ces signaux d'alerte pour adapter leur approche commerciale. L'accent doit également être mis sur les comportements à risque : pression tarifaire excessive sur un fournisseur captif, modification unilatérale des conditions sans justification économique, rupture brutale sans préavis proportionné, etc. Ces pratiques peuvent constituer une exploitation abusive même sans intention malveillante.
💡 La double validation, une preuve de diligence
La formation doit également couvrir les process de validation pour les décisions sensibles. Toute modification contractuelle majeure concernant un fournisseur en situation de dépendance doit faire l'objet d'une procédure d'escalade vers la direction juridique ou le management. Cette double validation limite les risques de dérapage et constitue une preuve de diligence en cas de contentieux.
Que dit la jurisprudence récente sur la dépendance économique ?
La jurisprudence française en matière d'abus de dépendance économique reste limitée, mais quelques décisions marquantes éclairent l'application de l'article L. 420-2 du Code de commerce. Ces cas d'espèce révèlent les critères retenus par les tribunaux et l'Autorité de la concurrence pour caractériser l'abus.
#1 L'affaire Apple : une condamnation emblématique confirmée en appel
La décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 constitue la sanction la plus lourde jamais prononcée par l'Autorité de la concurrence : 1,24 milliard d'euros au total, dont 1,1 milliard pour Apple. Cette condamnation historique sanctionne trois pratiques anticoncurrentielles, dont un abus de dépendance économique vis-à-vis des revendeurs premium (APR).
L'Autorité a démontré que les APR se trouvaient dans une situation de dépendance économique caractérisée. Ces PME spécialisées devaient consacrer 70 % de leurs ventes aux produits Apple pour conserver leur statut, ce qui les rendait totalement vulnérables aux décisions du fabricant.
Leur contrat leur interdisait d'ouvrir un magasin concurrent pendant six mois après la fin de la relation, et leur clientèle était si attachée à la marque qu'une sortie de l'univers Apple équivalait de facto à la perte totale de leur fonds de commerce.
L'abus s'est manifesté par un traitement discriminatoire systématique. Lors des lancements de nouveaux produits, les APR étaient privés de stocks tandis que les Apple Stores et le site internet étaient régulièrement approvisionnés. Cette pénurie qualifiée d’ « artificielle » et d’ « organisée » contraignait parfois les revendeurs à s'approvisionner eux-mêmes dans les Apple Stores comme de simples clients pour honorer les commandes de leurs propres clients. Apple maintenait également une incertitude permanente sur les remises et conditions commerciales, ce qui fragilisait davantage la rentabilité de partenaires déjà sous pression.
La Cour d'appel de Paris a confirmé ce grief en 2022, établissant qu'un rapport de force dans une relation bilatérale suffit à caractériser la dépendance économique, même sans position dominante au sens strict. Cette confirmation jurisprudentielle valide l'approche de l'Autorité : l'abus réside dans l'exploitation d'une vulnérabilité structurelle, indépendamment de la part de marché du dominant.
💡 Une combinaison de pratiques anticoncurrentielles
L'affaire Apple révèle comment plusieurs pratiques anticoncurrentielles peuvent se combiner pour créer un système d'exploitation global. Outre l'abus de dépendance économique, Apple a organisé une répartition de clientèle entre ses deux grossistes (« Tech Data » et « Ingram Micro ») pour « stériliser » le marché de gros. La marque a également imposé des prix de vente aux APR alignés sur ceux des Apple Stores. Cette stratégie permettait à Apple de bénéficier d'un réseau national sans investir dans des magasins en propre, tout en éliminant la concurrence intra-marque et en contrôlant totalement les prix de détail sur près de la moitié du marché français des produits Apple.
#2 L'affaire Carrefour : un échec de caractérisation malgré des pratiques restrictives
La décision n° 10-D-08 du 3 mars 2010 montre la difficulté à établir un abus de dépendance économique même face à des pratiques commerciales apparemment restrictives. Saisie par le Syndicat de l'Epicerie Française et de l'Alimentation Générale (SEFAG), l'Autorité de la concurrence a examiné un système contractuel complexe mis en place par Carrefour dans ses réseaux de proximité (Shopi, 8 à Huit, Marché Plus).
Les pratiques dénoncées révélaient pourtant un arsenal de clauses potentiellement captives :
- Contrats de franchise et d'approvisionnement de sept ans avec reconduction automatique ;
- Pénalités de rupture anticipée pouvant atteindre 75 000 euros ;
- Pactes de préférence de cinq ans après la fin du contrat ;
- Et participations minoritaires de 26 % permettant à Carrefour de bloquer les cessions.
Le système prévoyait également des clauses d'approvisionnement prioritaire avec des taux de fidélité minimum de 40 à 55 %, des ristournes conditionnelles au respect des prix conseillés et un contrôle informatique permanent via le logiciel « METI ».
Malgré ces éléments plutôt à charge, l'Autorité a conclu à l'absence d'abus de dépendance économique. La raison principale tient à l'hétérogénéité des situations contractuelles : les franchisés relevaient de sept régimes juridiques différents (franchisés personnes physiques, sociétés avec ou sans participation de Carrefour, avec ou sans pactes d'associés…), ce qui rend impossible la caractérisation d'une dépendance collective.
Par ailleurs, avec seulement 12 % de parts de marché en nombre de magasins, Carrefour ne constituait pas « un partenaire commercial incontournable » pour les candidats à la franchise.
💡 Un écosystème de filiales et de contrats interconnectés
Carrefour avait créé un écosystème de filiales spécialisées (Prodim pour la franchise, CSF pour l'approvisionnement, Selima pour les participations minoritaires, Soval pour l'immobilier) permettant de multiplier les liens contractuels.
Avec des participations de 26 %, Carrefour a créé des minorités de blocage, des grilles de valorisation qui sous-évaluent les parts lors des cessions (96 000 euros contre une offre concurrente d'un million d'euros) et le logiciel « METI » qui impose automatiquement les prix conseillés par Carrefour par défaut sur les étiquettes. Les franchisés devaient modifier les prix produit par produit pour s'écarter des tarifs Carrefour… une démarche impraticable avec plus de 5 000 références en moyenne par magasin.
#3 L'affaire « corbeille de la mariée » : l'échec de la qualification d'abus de position dominante
La décision n° 93-D-21 du 8 juin 1993 relative à l'acquisition de la Société européenne des supermarchés par le groupe Cora illustre les limites du contrôle des pratiques post-concentration. Saisi par le ministre de l'Économie, le Conseil de la concurrence a examiné les conditions dans lesquelles Cora avait renégocié ses relations avec 750 fournisseurs après cette acquisition.
Les pratiques dénoncées révélaient pourtant un système organisé d'extraction de valeur. Cora avait obtenu 105,9 millions de francs au titre d'une « Participation publi-promotionnelle forfaitaire » auprès de plus de 600 fournisseurs, représentant 0,4 à 6 % de leur chiffre d'affaires annuel. Cette rémunération s'ajoutait à des avantages rétroactifs, des allongements de délais de paiement et des menaces de déréférencement. Les fournisseurs eux-mêmes qualifiaient ces sommes de « contribution au financement du rachat » ou de « participation à la corbeille de la mariée ».
Malgré ces éléments, le Conseil a rejeté tous les griefs. L'absence de position dominante de Cora (4,7 % du marché national des hypermarchés et supermarchés) empêchait la qualification d'abus. Pour la dépendance économique, le Conseil a exigé la démonstration d'une pression irrésistible exercée sur chaque fournisseur individuellement. Cette approche restrictive a conduit à écarter même les cas les plus flagrants, certains fournisseurs ayant déclaré être « prêts à cesser leurs relations commerciales » plutôt que de subir les exigences de Cora.
💡 Une jurisprudence qui a établi les critères de l’abus de dépendance économique
C’est l'affaire Cora qui a établi cette jurisprudence très exigeante sur la preuve d’abus de dépendance économique. Le Conseil a en effet défini sept critères cumulatifs : importance de la part du chiffre d'affaires réalisé avec le distributeur, importance du distributeur dans la commercialisation des produits, facteurs ayant conduit à la concentration des ventes, existence de solutions alternatives, faiblesse des ressources financières, faiblesse des marges et absence de notoriété de la marque.
Même avec des fournisseurs réalisant 22 à 67,5 % de leur chiffre d'affaires avec Cora, le Conseil a exigé la démonstration d'une « pression à laquelle ils ne pouvaient se soustraire ». Cette approche restrictive explique la rareté des condamnations pour abus de dépendance économique pendant des décennies.
Provigis : sécuriser la surveillance de vos fournisseurs en situation de dépendance économique
En tant que Tiers de Collecte Probatoire (TCP), Provigis propose aux donneurs d’ordre une plateforme digitale qui centralise et automatise la collecte et l’authentification de plus de 50 types de documents : KBIS, attestations URSSAF, bilans financiers, certifications, assurances...
Les alertes automatiques d'expiration et de non-conformité garantissent une surveillance continue, indispensable pour démontrer la diligence du donneur d'ordre en cas de contentieux lié à l'abus de dépendance économique, entre autres.
La plateforme facilite l'identification des signaux d'alerte financière grâce aux contrôles automatisés via les API : retards dans les déclarations fiscales, difficultés de paiement URSSAF, dégradation de la santé financière... Ces éléments révèlent une entreprise sous tension qui risque la défaillance et qui serait susceptible d’exposer le donneur d'ordre au double risque :
- Juridique, pour avoir contribué à fragiliser un fournisseur dépendant ;
- Opérationnel, pour la rupture d'approvisionnement que la défaillance du fournisseur pourrait engendrer.
La centralisation documentaire sur Provigis constitue une piste d'audit sécurisée qui facilite les contrôles internes et externes. L'accès immédiat à l'ensemble des preuves juridiquement opposables permet de démontrer la vigilance active du donneur d'ordre. Réservez votre démo.
