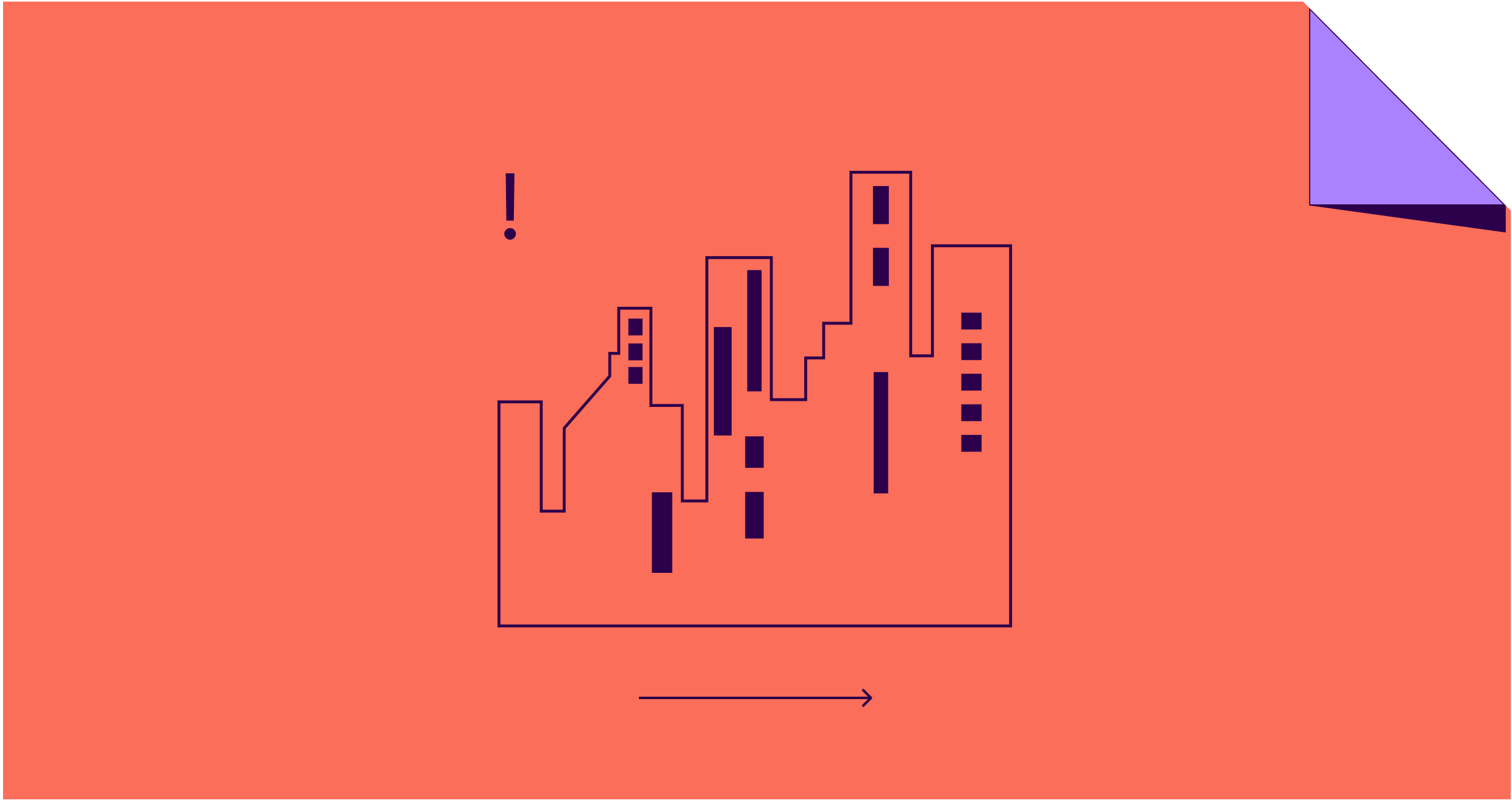
Risque supply chain : état des lieux et bonnes pratiques (2025)
Face à la turbulence du macroenvironnement et à la volatilité des tensions géopolitiques, la gestion des risques supply chain est devenue l’un des angles morts les plus coûteux dans la stratégie des grandes entreprises.
Longtemps cantonnée à des problématiques d’acheminement ou de respect des délais, elle impose aujourd’hui une compréhension beaucoup plus fine des interdépendances industrielles, des vulnérabilités digitales, des chocs géopolitiques et des mutations réglementaires. Chaque flux peut être interrompu, chaque dépendance peut devenir critique, chaque document manquant peut bloquer une opération de plusieurs millions.
Dans ce contexte, les entreprises doivent opérer un changement complet de posture : passer d’une logique d’optimisation linéaire à une gouvernance dynamique des maillons-clés, notamment tiers.
Ce déplacement du centre de gravité impose également de croiser des expertises qui ne se parlaient pas forcément avant : achats, conformité, supply, finance, IT, juridique. La chaîne d’approvisionnement devient une matière vivante, transversale, qui exige une vision synchronisée des dépendances opérationnelles et contractuelles.
Dans ce guide pratique, la rédaction de Provigis vous propose un état des lieux du risque supply chain en 2025, les chocs structurels qui le transforment et les méthodes pour reprendre le contrôle sur vos dépendances critiques.
Qu’est-ce que la supply chain ?
La supply chain désigne l'ensemble des flux physiques, informationnels et financiers qui relient les fournisseurs de matières premières jusqu'au client final. Cette chaîne couvre donc :
- L'approvisionnement, ou l’obtention des matières premières et composants nécessaires auprès des fournisseurs. Risques : défaillance fournisseur, retard de livraison, hausse des prix, non-conformité, rupture de matières premières…
- La production, qui est la transformation des matières premières en produits finis dans les usines ou ateliers. Risques : panne machine, défaut de fabrication, retard de production, grève, non-respect des standards qualité…
- Le stockage, ou l’entreposage temporaire des matières, produits semi-finis ou finis en attente de distribution. Risques : rupture ou surstock, détérioration, perte de traçabilité, incendie, vol, coût d’immobilisation…
- La distribution, ou l’acheminement des produits finis vers les clients ou les points de vente. Risques : retard de livraison, incident de transport, erreur de préparation, coût logistique, litige à la réception...
- La logistique inverse, qui consiste à gérer les retours, recycler ou réutiliser les produits après livraison. Risques : gestion complexe des retours, fraude, coût de traitement, non-conformité environnementale, perte de valeur sur les produits retournés…
Chaque maillon dépend des autres : une défaillance en amont peut paralyser l'ensemble du système.
Le périmètre du risque supply chain
Le risque supply chain correspond donc à tout événement susceptible de perturber ces flux et d'empêcher l'entreprise de livrer ses produits ou services. Ces perturbations peuvent provenir de sources internes (panne machine, erreur de planification, défaut qualité) ou externes (faillite d'un fournisseur, blocage douanier, cyberattaque sur un prestataire logistique).
Le périmètre du risque supply chain englobe donc :
- Les fournisseurs directs (tier 1) et indirects (tier 2, 3...) ;
- Les prestataires logistiques et transporteurs ;
- Les sites de production et entrepôts ;
- Les systèmes d'information qui pilotent les flux ;
- Les réglementations douanières et commerciales ;
- Les infrastructures critiques (ports, routes, réseaux électriques).
Cette vision élargie oblige les entreprises à surveiller bien au-delà de leurs murs. Elles doivent cartographier leurs dépendances, identifier leurs vulnérabilités et anticiper les ruptures potentielles sur l'ensemble de leur écosystème.
💡 L'interdépendance des acteurs amplifie l’exposition au risque
Quand un fournisseur de composants électroniques subit un incendie dans son usine, des centaines d'entreprises clientes voient leur production stoppée. Les constructeurs automobiles l'ont vécu avec la pénurie de semi-conducteurs : l'arrêt d'une fonderie à Taïwan a entraîné un retard ou une annulation de la livraison de millions de véhicules dans le monde.
L'évolution des chaînes d'approvisionnement mondiales depuis 2020
La pandémie de la COVID-19 a révélé la fragilité des supply chains étendues sur plusieurs continents. Les confinements successifs ont stoppé des usines entières en Asie, bloqué des ports majeurs et désorganisé le transport maritime mondial. Le porte-conteneurs Ever Given, échoué dans le canal de Suez en mars 2021, a immobilisé 400 navires et perturbé 12 % du commerce mondial pendant une semaine.
Comme partout ailleurs, les entreprises françaises ont découvert leur dépendance critique aux fournisseurs lointains :
- Sanofi dépendait de sites chinois pour produire le paracétamol, ce qui a créé des tensions d'approvisionnement dans toutes les pharmacies de l’Hexagone ;
- Les usines Stellantis de Sochaux et Mulhouse ont dû arrêter leurs lignes de production faute de semi-conducteurs.
💡 Le chiffre à connaître
Ces ruptures ont réhabilité les stocks tampons, pourtant « chassés » depuis des années au nom du Lean Management. Un stock tampon désigne une réserve intermédiaire de produits ou de composants, maintenue volontairement pour absorber les aléas de la production, des livraisons ou de la demande.
Depuis, les approvisionnements ont connu un phénomène de régionalisation. Selon une étude McKinsey réalisée en 2024, 60 % des entreprises mondiales ont restructuré leurs réseaux pour rapprocher la production du lieu de consommation. Renault a par exemple relocalisé une partie de sa production de batteries électriques avec Verkor à Dunkerque, et Michelin investit dans des usines européennes pour sécuriser sa production face aux aléas du transport intercontinental.
Les tensions géopolitiques actuelles, notamment les restrictions américaines sur les puces chinoises, les quotas européens sur les matières premières critiques, la guerre en Ukraine et les tarifs douaniers de l’administration Trump perturbant les approvisionnements en néon pour l'industrie électronique. La supply chain devient avant tout un enjeu de souveraineté.
Cartographie des risques majeurs dans la supply chain
#1 Risques géopolitiques et instabilité mondiale
Les risques géopolitiques frappent sans prévenir et peuvent anéantir des années de construction de la supply chain. Il suffit d’un décret présidentiel, d’une escalade militaire ou d’un blocage douanier pour que :
- Votre principal fournisseur devienne inaccessible, comme les industriels européens qui s'approvisionnaient en néon ukrainien ;
- Vos marchandises soient bloquées en mer, comme les centaines de navires immobilisés lors du blocage du canal de Suez ;
- Vos contrats deviennent illégaux du jour au lendemain, comme les entreprises qui commerçaient avec la Russie après les sanctions de 2022.
À cause de son caractère imprévisible et critique, l'instabilité géopolitique constitue le premier risque identifié par 58 % des dirigeants selon une étude SAP, devant les pénuries de matières premières (44 %).
💡 Le chiffre à connaître
Les deux usines ukrainiennes de Cryoin et Ingas produisaient 70 % du néon mondial, un élément indispensable aux semi-conducteurs. Intel, TSMC et Samsung ont dû activer des sources alternatives en Chine et au Japon avec des surcoûts allant de 300 à 500 %.
L'administration Trump a imposé depuis février 2025 des tarifs de 25 % sur le Canada et le Mexique, et 10 % puis 20 % sur la Chine. Volkswagen, qui avait investi un milliard dans son usine de Puebla au Mexique pour servir le marché US, a vu sa rentabilité s'évaporer. Stellantis doit revoir sa stratégie après avoir misé sur ses sites mexicains de Saltillo et Toluca.
Les missiles Houthis transforment la mer Rouge en zone de guerre. Le trajet Shanghai-Rotterdam passe de 19 à 33 jours via le Cap de Bonne-Espérance. IKEA a vu ses conteneurs de meubles bloqués pendant des semaines. De son côté, Maersk facture désormais un « Transit Disruption Surcharge » de 500 à 1 000 dollars par conteneur.
Citons également le jeu des sanctions et contre-sanctions qui piège les entreprises :
- Apple dépend de la Chine pour assembler 90 % de ses iPhone mais doit respecter les restrictions américaines sur les technologies ;
- BYD ne pourra peut-être plus acheter les puces Nvidia nécessaires à ses véhicules autonomes à court terme ;
- ASML doit cesser de livrer ses machines de lithographie EUV à la Chine.
#2 Risques climatiques et catastrophes naturelles
Les risques climatiques englobent tous les événements météorologiques extrêmes et géologiques susceptibles de perturber les opérations : ouragans, inondations, sécheresses, tremblements de terre, tsunamis, incendies... Ces événements détruisent simultanément les infrastructures physiques (usines, entrepôts et ports), les réseaux de transport (routes, voies ferrées, aéroports) et les systèmes supports (électricité, eau et télécommunication notamment).
Le nombre de catastrophes naturelles majeures est passé de moins de 100 par an entre 1970 - 2000 à une moyenne de 350 à 500 par an sur la période 2001 - 2020 selon l'ONU. Cette accélération rend obsolètes les modèles de prévision basés sur les données historiques. Les entreprises doivent désormais intégrer les projections climatiques pour anticiper des phénomènes d’une fréquence inédite dans l’Histoire de l’humanité.
Voici quelques exemples récents de catastrophes climatiques qui ont impacté la supply chain mondiale :
- Les inondations de juin 2024 en Allemagne : 30 entreprises industrielles touchées pendant plusieurs semaines ;
- Le séisme de janvier 2024 au Japon : arrêt des usines de semi-conducteurs à Kumamoto, avec une aggravation de la pénurie mondiale ;
- Les inondations de juillet 2024 en Corée du Sud, avec la perturbation de Samsung et SK Hynix qui produit 60 % des puces mémoire mondiales.
- L’ouragan Maria à Porto Rico (2017) et l’arrêt de la production de sérum physiologique. Pénuries dans plusieurs hôpitaux canadiens et américains.
#3 Risques cyber et vulnérabilités digitales
CDK Global pensait faire une mise à jour de routine. Le 19 juin 2024, un ransomware a paralysé 15 000 concessionnaires automobiles nord-américains et forcé les vendeurs à revenir au papier et au crayon. Les pertes dépassent le milliard de dollars. Paradoxalement, l'attaque est venue d'un système censé faciliter leurs opérations.
La digitalisation massive des supply chains fait que chaque connexion, chaque API et chaque accès partenaire devient une porte dérobée potentielle (par rebond). Les attaques via la supply chain ont explosé de 431 % entre 2021 et 2023, selon une étude Cowbell. Les cybercriminels ont compris qu'il est plus rentable de viser un fournisseur de logiciels que d'attaquer frontalement 1 000 entreprises.
L'incident CrowdStrike de juillet 2024 est probablement le meilleur exemple de cette fragilité systémique. Une simple mise à jour défectueuse (pas même malveillante) a fait crasher 8,5 millions de systèmes Windows dans le monde : aéroports paralysés, hôpitaux au ralenti, services d'urgence inopérants...
💡 Le chiffre à connaître
Les ransomwares sont aujourd’hui l'arme favorite des pirates informatiques. Change Healthcare l'a appris à ses dépens en février 2024, avec une attaque par rançongiciel qui a séquestré 100 millions de dossiers médicaux et coûté 2,87 milliards de dollars de pertes.
L’Hexagone n'est évidemment pas épargné, puisque près de la moitié (47 %) des entreprises françaises ont subi au moins une cyberattaque majeure en 2024. Le pays est le 4e plus ciblé au monde.
#4 Risques fournisseurs et défaillances tierces
Quand Hanjin Shipping s'est effondré en août 2016, 14 milliards de dollars de marchandises se sont retrouvés bloqués en mer sur 98 navires. Plus de 350 000 conteneurs en transit, des ports qui refusaient l'accostage et des équipages abandonnés en pleine mer. Samsung avait 38 millions de dollars de smartphones flottant quelque part dans le Pacifique. La septième compagnie maritime mondiale venait de paralyser 3,2 % du transport maritime global.
💡 Le chiffre à connaître
Les délais de paiement de Hanjin étaient passés à 180 jours quelques mois avant sa chute. Les demandes de renégociation tarifaire, les retards de livraison récurrents et les changements fréquents d'interlocuteurs sont autant de signaux rouges pour les fournisseurs... Mais combien d'acheteurs surveillent vraiment la santé financière de leurs fournisseurs tier-2 ou tier-3 ?
La défaillance d'un fournisseur critique s’explique généralement par des difficultés financières plus ou moins masquées, la perte de compétitivité, de mauvais investissements ou un simple effet domino d'autres faillites. Environ 25 % des entreprises interrogées dans une enquête réalisée par Achilles ont subi une disruption majeure liée à la faillite d'un fournisseur.
L’industrie allemande a récemment subi une série de faillites, avec un risque fournisseur qui s’est matérialisé pour un pan important de l’économie du pays. Au premier semestre 2024, 20 équipementiers générant plus de 10 millions d'euros de CA ont déposé le bilan, une hausse de 60 % sur un an. En cause : une transition électrique mal anticipée, des investissements hasardeux dans des technologies non rentables et une baisse de commandes des constructeurs.
💡 L’effet boule de neige
En 2018, Carillion, géant britannique de la construction, s'écroule et laisse 30 000 fournisseurs avec un total d’un milliard de livres sterling d’impayés. Les sous-traitants qui dépendaient de Carillion pour 30 % ou plus de leur activité font faillite immédiatement. C'est la cascade : quand un gros vacille ou tombe, les petits disparaissent.
#5 Risque réglementaire et de conformité
Le risque réglementaire est lié à l'évolution des normes, des directives ou des législations qui encadrent l’activité économique. Dans la supply chain, il concerne principalement les obligations de vigilance sur les fournisseurs, les contraintes douanières, la traçabilité environnementale et sociale et les contrôles documentaires exigés par les autorités.
Concrètement, ce risque entraîne :
- Des coûts de mise en conformité immédiats avec des audits fournisseurs, des contrôles documentaires et une cartographie des risques ;
- Des sanctions financières lourdes en cas d’écart avéré avec des amendes, une majoration des droits de douane, voire un blocage des marchandises ;
- Un risque réputationnel fort qui peut entraîner la perte de clients ou de marchés.
En 2024, la directive européenne CSDDD est venue obliger les grandes entreprises à prouver leur maîtrise des risques environnementaux et sociaux chez tous leurs sous-traitants directs. Une simple non-conformité peut entraîner des amendes atteignant 5 % du chiffre d’affaires mondial.
💡 Le risque tiers dans la supply chain
En 2025, Armani a subi une amende de 3,5 millions d’euros pour avoir laissé perdurer des violations de la législation du travail chez plusieurs de ses sous-traitants italiens. Et entre juin et octobre 2022, la douane américaine a bloqué plus de 1 000 cargaisons de panneaux solaires soupçonnées de contenir des composants issus du travail forcé au Xinjiang (Chine), en application de la loi Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA).
L’état des lieux 2025 : les entreprises face aux risques supply chain
Si le risque supply chain a toujours été mouvant et volatile, il a largement changé de nature et d’intensité avec la pandémie de la Covid-19. Cette dernière a servi d’électrochoc pour les États et les grandes entreprises.
Selon Gartner, 87 % des responsables supply chain estiment que leurs chaînes logistiques sont excessivement exposées à des risques systémiques liés à leur complexité mondiale et à la multiplicité des fournisseurs indirects (tiers 2 ou 3).
Face aux disruptions, les entreprises sont désormais contraintes d'intégrer des scénarios plus extrêmes dans leur planification. Selon une étude SAP, 64 % des entreprises ont significativement augmenté leurs stocks de précaution pour pallier les pénuries chroniques apparues depuis la pandémie. Mais cette politique, coûteuse en immobilisations financières, reste contestée : 32 % des entreprises interrogées par McKinsey en 2024 déclarent avoir finalement réduit ce type de stock, préférant visiblement supporter le risque opérationnel plutôt que financier.
Sur le front des risques réglementaires et environnementaux, les entreprises françaises et européennes font face à des exigences ESG renforcées qui conditionnent désormais directement leurs stratégies d'approvisionnement. Selon l'Association for Supply Chain Management (ASCM, 2023), 68 % des grandes entreprises déclarent devoir ajuster fréquemment leurs pratiques logistiques pour répondre aux évolutions rapides de la réglementation environnementale européenne.
Enfin, le numérique reste une épée à double tranchant. Les supply chains devenues entièrement dépendantes des outils digitaux se trouvent particulièrement vulnérables : Forbes indique que plus de 80 % des incidents cyber subis par les entreprises en 2023 étaient directement liés à des attaques sur leurs fournisseurs ou prestataires.
💡 Le risque supply chain : une affaire d’arbitrage
Une partie des grandes entreprises gère encore les risques supply chain avec une approche largement réactive : elles investissent massivement pour compenser les ruptures plutôt que pour les anticiper. La régionalisation réduit certes la dépendance géographique, mais elle augmente généralement le coût unitaire. Dans ce contexte, le véritable enjeu devient l’arbitrage permanent entre les coûts opérationnels, la flexibilité industrielle et la capacité à absorber des chocs imprévus. Gagner en efficacité nécessite désormais de basculer vers une anticipation fine, basée sur l’évaluation rigoureuse et permanente des vulnérabilités de chaque maillon de la chaîne d’approvisionnement.
Les méthodes d'identification et d'évaluation des risques
#1 Cartographie dynamique des dépendances fournisseurs
La turbulence du macroenvironnement et la volatilité du risque font qu’il ne suffit plus d’identifier les dépendances fournisseurs pour gérer sa supply chain.
Il s’agit désormais de cartographier en temps réel l'ensemble des liens directs et indirects qui relient chaque fournisseur aux flux opérationnels critiques de l'entreprise. Concrètement :
- Il faut passer d’une cartographie statique (simple inventaire périodique des tiers)…
- à une cartographie dynamique, capable d'intégrer immédiatement toute variation d'approvisionnement ou de condition réglementaire susceptible d’impacter l'activité.
Le vrai défi opérationnel consiste à hiérarchiser clairement les fournisseurs, non plus selon leur seul volume d’affaires, mais selon leur impact en cas de défaillance : durée de remplacement, disponibilité des alternatives, coûts supplémentaires immédiats, etc.
Cette approche permet aux équipes achats d’anticiper la réallocation rapide des flux ou la négociation préventive de capacités supplémentaires avec des partenaires alternatifs. C’est précisément cette gestion proactive qui réduit l’impact financier et opérationnel des crises.
💡 Le risque supply chain : une affaire d’arbitrage
La cartographie opérationnelle des risques supply chain repose sur des flux reconstitués à partir de données réelles : points de passage, fréquences, volumes, modes de transport, prestataires impliqués... Elle distingue les flux majeurs des flux secondaires, visualise les zones de concentration ou de dépendance critique, intègre les délais moyens constatés, les écarts-types et les retards récurrents. C’est une base de travail utilisée pour orienter les audits et structurer les plans de continuité d’activité.
#2 Hiérarchisation des fournisseurs par criticité
Tous les fournisseurs ne présentent pas le même risque pour la continuité de l’activité. Ce qui compte, c’est la capacité à absorber une rupture : existe-t-il une alternative rapide, quel est le délai de remplacement, quels surcoûts engendre une bascule et dans quelle mesure la production ou la prestation peut continuer sans lui ?
Un fournisseur est « critique » quand son absence bloque directement la (ou une) chaîne de valeur. Ce n’est pas forcément une question de volume d’achat ou de fréquence de livraison. Un partenaire qui intervient rarement peut être plus décisif qu’un autre sollicité chaque semaine si son produit est indispensable et difficile à remplacer.
Il faut donc classer les fournisseurs en fonction :
- de leur rôle dans les processus ;
- du nombre d’alternatives fiables et déjà qualifiées ;
- des délais d’obtention en cas de re-sourcing ;
- de l’effet d’une rupture sur les clients ou les opérations internes.
Cette cartographie opérationnelle évite les surprises : un prestataire perçu comme secondaire peut en réalité exposer l’entreprise à un arrêt complet en cas d’incident. Mieux vaut le savoir avant qu’il ne soit trop tard.
#3 Audit continu des signaux faibles dans les relations fournisseurs
Certains incidents ne laissent aucune trace dans les indicateurs habituels. Par exemple une hausse des délais de réponse, un changement discret dans les conditions de paiement, une baisse d’activité sur des flux secondaires ou un turnover anormal côté interlocuteurs.
Ces signaux faibles échappent aux grilles d’analyse classiques quand ils ne sont pas remontés en temps réel. Le principe consiste donc à capter, croiser et historiser tous les événements mineurs qui sortent de la routine.
Les équipes achats peuvent croiser les remontées terrain, les logs systèmes et les données de suivi (extractions ERP, tickets SAV, historiques de litiges) pour détecter les déviations récurrentes. Les alertes automatiques se déclenchent dès qu’un écart s’installe dans la durée (même mineur) : fréquence des relances, retard de transmission de documents, absence inhabituelle de certains livrables, multiplication de corrections ou d’ajustements sur les factures…
Cette collecte permet de remonter les cas qui n’explosent pas tout de suite, mais qui préparent le terrain à des ruptures plus lourdes. On sort du mode réactif : chaque dérive statistique alimente le scoring de risque fournisseur, et les fournisseurs concernés peuvent être revus ou réévalués avant même l’apparition d’un défaut majeur.
💡 Une bonne pratique… qui ne se justifie pas toujours
La démarche implique une analyse fine, parfois lourde à maintenir : elle vise surtout les fournisseurs majeurs, les approvisionnements sans solution de secours immédiate et les secteurs exposés à des pénalités fortes en cas d’incident (industrie lourde, aéronautique, électronique, sous-traitance réglementée…). Sur les familles d’achats banalisés ou à faible enjeu, le suivi classique suffit largement.
#4 Analyse d’incidents passés sur les flux critiques
Les ruptures ou dysfonctionnements passés sont une mine d’informations qu’il faut impérativement exploiter. Chaque incident laisse forcément des traces : délais de reprise, volume de production perdu, réactions des clients, coûts engendrés, improvisations ou bricolages qui ont permis de limiter la casse...
L’analyse doit aller au-delà des causes pour objectiver l’enchaînement des événements et en extraire les faiblesses structurelles, par exemple :
- L’absence de plan « B » ;
- La sous-estimation des délais de remise en marche ;
- La dépendance à un intervenant-clé ;
- Le manque de visibilité sur les stocks réels, etc.
On reconstitue alors le scénario : qui a alerté, à quel moment la rupture a été détectée, quels signaux ont été ignorés, combien de temps l’équipe a-t-elle mis à basculer sur une solution alternative, quels arbitrages ont été faits dans l’urgence ?
💡 À savoir
Chaque incident documenté alimente une base d’expériences qu’il faudra intégrer dans les scénarios de gestion de crise, la réévaluation des fournisseurs et les plans de continuité d’activité. Le retour d’expérience sert aussi d’argument face aux directions ou aux clients internes pour justifier l’investissement dans la prévention et la robustesse des chaînes critiques.
#5 Mesure de la capacité à réaffecter les approvisionnements
Combien de temps pour basculer sur un autre fournisseur ? Quel stock tampon permet de tenir sans rupture ? Sur quels produits ou services une alternative qualifiée existe-t-elle déjà, avec quel délai de contractualisation, quelle différence de coût, quelle adaptation logistique ou qualité ?
Les équipes achats et supply doivent tester le plan « B » avant qu’il ne s’impose :
- Commande « test » chez un concurrent pour valider la réactivité et la compatibilité logistique
- Simulation d’arrêt de livraison sur une semaine : qui tient, qui cale, qui absorbe la charge sans incident ?
- Consultation « flash » pour mesurer le temps de réaction du marché (au-delà des promesses) ;
- Révision du plan de transport : combien de jours sans flux avant blocage sur la chaîne aval ?
Le fichier des fournisseurs alternatifs ne vaut que s’il est validé opérationnellement. Les marges de manœuvre doivent s’évaluer sur le terrain.
#6 Suivi documentaire : collecte, authentification et suivi
La conformité protège le droit d’opérer des fournisseurs et, par construction, la continuité des flux dans la chaîne d’approvisionnement. Un badge refusé à l’entrée d’un site, un camion ADR immobilisé, une assurance obsolète, un contrôle qui gèle un chantier… tout part souvent d’un document expiré ou manquant. Le risque supply chain se matérialise quand le partenaire ne peut plus prouver qu’il a le droit d’exécuter ce qu’on lui demande.
Le socle documentaire du suivi de conformité doit être défini par famille d’achats, avec :
- Un socle commun : les registres officiels et les attestations sociales ;
- Des pièces liées au métier : assurances (RCP, décennale, flotte), licences de transport, normes QHSE (ISO 9001/14001/45001, MASE), habilitations, exigences produits (REACH/ROHS, marquage CE), référentiels sectoriels…
Chaque pièce doit porter trois données pour valider son exploitation : sa date d’expiration, sa portée opérationnelle (site, pays, produit…) et sa criticité. Cette granularité permettra d’éviter les faux positifs : une licence fluviale périmée ne bloque pas un flux routier qui reste conforme.
Pour que le dispositif de suivi soit opérationnel, il devra s’exécuter dès l’onboarding, avec un circuit d’homologation calé sur la cartographie de risques. Au moment de la commande, il s’agira de vérifier les pièces exigées par la prestation, avec une traçabilité rigoureuse : validations, dérogations, relances... Les échéances sont programmées avec des alarmes à plusieurs jours ou semaines.
Il conviendra aussi de recueillir des justificatifs liés à la continuité d’activité, comme un plan de continuité (PCA), afin de garantir la résilience du fournisseur en cas d’aléa. Parallèlement le contrat devra également intégrer des stipulations précises permettant de sécuriser la chaîne de valeur et de limiter les risques de rupture.
Le pilotage doit enfin reposer sur des indicateurs opérationnels :
- Taux de complétude et de validité par famille d’achats ;
- Délai d’obtention d’un document critique ;
- Nombre de commandes bloquées pour non-conformité ;
- Temps moyen de remise en conformité, etc.
Le score compliance devient aussi structurant que l’OTD ou la qualité dans l’évaluation des fournisseurs. Un prestataire ponctuel peut donc être disqualifié si son droit d’opérer est incertain.
Provigis : la plateforme digitale pour maîtriser le risque fournisseurs à la source
Provigis est un Tiers de Collecte Probatoire fondé en 2009 à l’initiative du Club des Acheteurs. Notre mission : sécuriser les relations entre donneurs d’ordres et fournisseurs en automatisant les vérifications de conformité à l’échelle.
Utilisée dans les secteurs du transport, de la logistique, de l’aéronautique, de l’énergie, de l’IT ou encore de la construction, la plateforme digitale Provigis centralise tous les documents attendus dans le cadre des obligations de vigilance et du suivi fournisseurs :
- Attestations URSSAF ;
- Licences de transport ;
- Assurances RCP ;
- Bilans financiers ;
- Certifications QHSE ;
- Engagements RSE ;
- Déclarations Reach/ROHS, non-présence de substances dangereuses ;
- Certificat d’origine, fiches de données de sécurité (FDS), certificat de matières dangereuses, etc.
💡 Automatisation et piste d’audit
Chaque pièce est contrôlée automatiquement, horodatée, rattachée à un fournisseur et intégrée dans une piste d’audit.
En complément, Provigis propose un système de scoring de conformité, des relances automatiques, des questionnaires personnalisables (Sapin II, empreinte carbone, éthique…), un module de signature électronique et la possibilité d’extraire les métadonnées. Notre connecteur certifié Ivalua permet enfin une synchronisation automatique avec les portefeuilles fournisseurs existants et une gestion intégrée des alertes.
Plusieurs grands groupes utilisent déjà Provigis : FedEx, Air France, Sanef/Sapn, SQLI ou Covea ont intégré la plateforme dans leur écosystème. Réservez votre démo !
