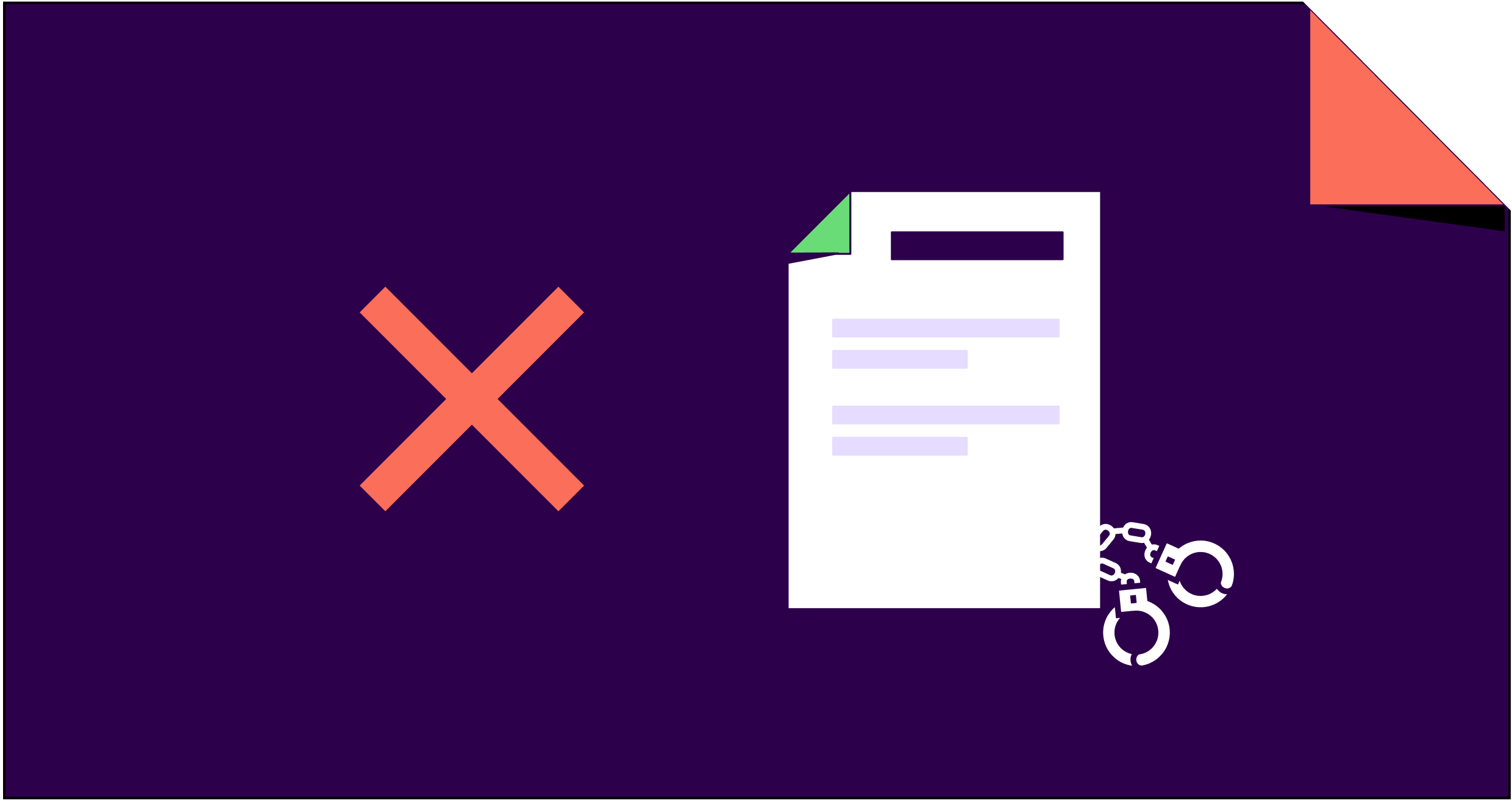
Travail dissimulé : risques, sanctions et vigilance (2025)
Travail dissimulé : définition, risques et obligation de vigilance (2025)
Le travail dissimulé ne recule pas en France. C’est pourquoi l'administration intensifie ses contrôles, notamment en ciblant les chaînes de sous-traitance. Les donneurs d'ordre qui n'ont pas vérifié leurs prestataires, dans le cadre prévu par l’obligation de vigilance, s'exposent à la solidarité financière sur les cotisations éludées, avec des montants qui se chiffrent parfois en dizaines de milliers d'euros par dossier.
Chez Provigis, nous observons que les entreprises sous-estiment parfois l'étendue de leur obligation de vigilance et ne mesurent pas les exigences probatoires lors d'un contrôle (attestations périmées, documents non vérifiés, relances non documentées, etc.).
Dans cet article, la rédaction revient sur la définition juridique et les formes de travail dissimulé reconnues par le Code du travail, les secteurs les plus exposés, les sanctions encourues et les preuves à constituer pour démontrer votre conformité en cas de contrôle.
L’état des lieux du travail dissimulé en France (2025)
Les données rendues publiques en 2025 par le Haut Conseil du financement de la protection sociale (HCFiPS) estiment que les cotisations sociales éludées se situent entre 8 et 10,3 milliards d’euros.
Ce montant concerne le régime général et l’Unédic, hors secteur agricole. L’ordre de grandeur est stable depuis dix ans, ce qui indique non pas une amélioration, mais bien une fraude installée à haut niveau, avec un noyau dur que les contrôles de l’Urssaf ne parviennent pas à éroder, malgré :
- La multiplication des campagnes de contrôle ;
- La modernisation des outils d’analyse ;
- La montée en puissance des échanges de données entre administrations.
Le volume total de l’économie non observée, c’est-à-dire les activités qui échappent partiellement ou totalement aux obligations fiscales et sociales, reste proche de 65 milliards d’euros de valeur ajoutée. Ce poids équivaut à environ 2,5 % du PIB, un niveau constant depuis 2015 selon l’INSEE.
Globalement, la part dissimulée du travail salarié reste comprise entre 2,5 % et 3 % du volume total d’emploi privé. Ce ratio correspond à plus d’un demi-million de travailleurs.
Quels sont les secteurs et les profils les plus concernés par le travail dissimulé ?
Le travail dissimulé touche de manière disproportionnée les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre et à marges faibles :
- Bâtiment et travaux publics, où la sous-traitance en cascade favorise les omissions de déclaration ;
- Restauration et hôtellerie, où le recours à des extras non déclarés est profondément ancré dans le quotidien opérationnel ;
- Services à la personne et sécurité privée, marqués par des horaires fractionnés et un turn-over élevé ;
- Logistique, avec la multiplication des contrats courts et la sous-traitance quasi-systématique du transport.
L’Urssaf note également une progression des fraudes dans le secteur tertiaire, en particulier dans les activités de conseil, d’informatique et de communication, où la dissimulation d’emploi salarié prend souvent la forme d’un statut d’indépendant fictif. Cette tendance s’est renforcée avec l’essor des plateformes et des micro-entreprises qui dépendent parfois d’un donneur d’ordre unique.
💡 À savoir
Les travailleurs étrangers sont surreprésentés dans les situations de dissimulation d’activité, notamment dans le BTP et l’agriculture. Ces cas relèvent le plus souvent de l’absence de déclaration à l’embauche et/ou de la méconnaissance des règles de détachement.
L’Urssaf annonce « un résultat historique » dans la lutte contre le travail dissimulé (2025)
Le volume des contrôles Urssaf progresse régulièrement depuis dix ans. En 2024, les organismes de recouvrement ont procédé à 51 000 actions de contrôle, soit +12 % par rapport à 2019. Cette hausse s’explique par l’usage du datamining et des croisements automatiques de fichiers qui ciblent les écarts entre les déclarations sociales, la facturation et les flux bancaires.
Les redressements notifiés pour travail dissimulé ont atteint 1,6 milliard d’euros en 2024, contre 1,4 milliard cinq ans plus tôt : les montants moyens par dossier augmentent à la faveur d’un ciblage plus précis des structures à risque. L’Urssaf, la MSA et la DGFiP coordonnent désormais leurs enquêtes et bénéficient de l’appui des services de police et de gendarmerie dans les cas de fraude organisée.
💡 L’administration expérimente de nouveaux outils de détection
L’administration expérimente en effet des procédures de détection automatisée avec l’analyse de séries temporelles de paie, le repérage d’écarts récurrents entre l’activité déclarée et la consommation d’énergie et la surveillance des flux de détachement. Le contrôle est donc de moins en moins aléatoire.
Qu’est-ce que le travail dissimulé, au juste ?
Le Code du travail définit le travail dissimulé comme une activité ou un emploi exercé hors du champ des obligations sociales et fiscales. L’infraction repose sur deux éléments :
- Un fait matériel, c’est-à-dire l’omission d’une formalité obligatoire (immatriculation, déclaration préalable à l’embauche, déclaration de rémunérations, remise de bulletin de paie) ;
- Un élément intentionnel, à savoir l’acte volontaire d’échapper à ces obligations.
Le travail dissimulé couvre également les faux statuts indépendants, où la personne se présente comme auto-entrepreneur mais exerce en réalité sous subordination directe d’un donneur d’ordre. Dans ce cas, la relation est requalifiée en contrat de travail, avec les conséquences associées.
💡 Faux travail indépendant : la Cour de cassation rappelle les limites (septembre 2025)
Une décision du 3 septembre 2025 a rappelé l’importance du critère du « lien de subordination » dans la caractérisation du faux travail indépendant. L’affaire concernait un collaborateur sous convention de mandat. Les juges ont retenu l’existence d’un lien de subordination : ordres donnés, le contrôle de l’activité et pouvoir de sanction. La Cour a par ailleurs écarté l’argument de la « maladresse contractuelle » : le simple fait d’utiliser sciemment un statut d’indépendant pour une relation salariée suffit à établir l’intention de dissimulation.
Quelles sont les trois formes du travail dissimulé ?
Le Code du travail distingue trois formes de dissimulation : la dissimulation d’activité, la dissimulation d’emploi salarié et la dissimulation de revenus. Ces infractions peuvent être cumulées lorsque l’entreprise dissimule à la fois son activité et tout ou partie des emplois qu’elle génère.
Ces trois formes partagent une caractéristique commune : la volonté d’éluder les obligations déclaratives pour réduire les coûts. La nature du manquement détermine l’autorité compétente et la procédure applicable : l’Urssaf pour la dissimulation d’emploi, l’administration fiscale pour la dissimulation de revenus et l’inspection du travail ou le parquet en cas de cumul.
1. La dissimulation d’activité
Elle s’applique lorsqu’une personne physique ou morale exerce une activité professionnelle sans procéder aux déclarations obligatoires d’immatriculation ou de cotisations sociales et fiscales.
Cela concerne, par exemple, une entreprise non inscrite au registre du commerce et des sociétés, ou une activité exercée sans déclaration auprès de l’Urssaf ou de la MSA.
Cette forme de dissimulation vise la structure elle-même : elle opère sans existence légale, même si des prestations sont facturées.
2. La dissimulation d’emploi salarié
Elle correspond à la situation d’un employeur qui ne déclare pas l’embauche d’un salarié (absence de DPAE) ou occulte tout ou partie de la rémunération versée. La dissimulation peut aussi résulter de l’absence de bulletin de paie, de fiches incomplètes ou de l’omission volontaire d’heures supplémentaires.
Le salarié est alors privé des droits liés à la protection sociale : assurance maladie, retraite, chômage et couverture en cas d’accident du travail.
L’entreprise, elle, élude les cotisations dues et se place en concurrence déloyale avec celles qui respectent leurs obligations.
3. La dissimulation de revenus
Cette forme concerne principalement les travailleurs indépendants ou les dirigeants d’entreprise qui ne déclarent pas la totalité de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes. Elle peut résulter d’une facturation partielle, d’une comptabilité volontairement incomplète ou du recours à des circuits de paiement dissimulés.
L’administration considère cette pratique comme du travail dissimulé dès lors qu’elle traduit une intention d’échapper aux cotisations sociales ou à l’impôt.
Quels sont les fondements légaux du travail dissimulé ?
Le cadre juridique du travail dissimulé repose sur un ensemble d’articles du Code du travail, du Code de la sécurité sociale et du Code pénal. Ces textes précisent la définition de l’infraction, les obligations des employeurs et les mécanismes de sanction.
Le Code du travail
Les articles L.8221-3 à L.8221-5 définissent les comportements constitutifs du travail dissimulé :
- Absence de déclaration préalable à l’embauche (DPAE) ;
- Non-remise du bulletin de paie ou mention inexacte du nombre d’heures ou du salaire ;
- Omission d’immatriculation auprès des organismes sociaux ou fiscaux.
Les articles L.8222-1 à L.8222-6 encadrent la responsabilité du donneur d’ordre. L’entreprise doit impérativement vérifier que ses cocontractants respectent bien leurs obligations sociales. En cas de manquement, elle peut être tenue solidairement responsable du paiement des impôts, cotisations et rémunérations dus, au titre de l’obligation de vigilance que nous détaillons plus bas, dans la partie « L’obligation de vigilance : le socle juridique du contrôle des tiers ».
Les articles L.8251-1 et suivants sanctionnent le travail illégal lorsqu’il implique des travailleurs étrangers sans titre de séjour ou sans autorisation de travail.
Le Code de la sécurité sociale
Les organismes de recouvrement (Urssaf et MSA) interviennent sur la base des articles L.243-7 et L.243-7-1, qui leur confèrent un pouvoir de contrôle et de redressement en cas d’infraction au travail dissimulé.
Ils peuvent reconstituer les bases de cotisations éludées, appliquer des majorations (jusqu’à 25 % des sommes dues) et, le cas échéant, transmettre le dossier au parquet.
L’article L114-12-1, dans sa version issue de la loi du 30 juin 2025, institue désormais un répertoire national commun aux régimes obligatoires de sécurité sociale. Cet outil vient fiabiliser les échanges d’informations entre administrations et détecter les anomalies de déclaration.
Le Code pénal
Le travail dissimulé peut donner lieu à des poursuites pénales lorsque les faits révèlent une organisation frauduleuse, une récidive ou des manœuvres aggravantes comme l’usage de faux et la fraude en bande organisée (voir partie suivante).
Quels sont les risques du travail dissimulé pour les entreprises ?
Le travail dissimulé expose les entreprises à une série de sanctions financières, sociales et pénales prévues par le Code du travail et le Code de la sécurité sociale. Au-delà du redressement des cotisations éludées, les dirigeants peuvent être poursuivis à titre personnel pour délit de travail dissimulé, avec des peines d’amende et d’emprisonnement.
L’impact de la condamnation déborde sur la réputation, la confiance des partenaires économiques et même l’accès aux marchés et à certains dispositifs d’aide publique.
Les sanctions encourues
Le Code du travail prévoit jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour une personne physique, et jusqu’à 225 000 euros pour une personne morale. Ces peines peuvent s’accompagner de mesures complémentaires :
- Fermeture administrative de l’établissement ;
- Exclusion des marchés publics pendant cinq ans ;
- Confiscation du matériel utilisé pour la fraude ;
- Publication du jugement.
Les organismes de recouvrement disposent d’un droit de reprise sur trois ans, voire cinq ans en cas de manœuvres frauduleuses. Le redressement couvre l’intégralité des cotisations et contributions non versées, avec une majoration de 25 % des sommes dues.
Le salarié non déclaré peut, de son côté, réclamer les salaires et indemnités correspondants, ce qui alourdit le coût global pour l’entreprise.
💡 À savoir
Les dirigeants peuvent également être poursuivis personnellement lorsque les faits traduisent une volonté de dissimulation. Dans les cas les plus graves (récidive ou fraude organisée), le parquet peut retenir des circonstances aggravantes relevant du Code pénal.
Les effets collatéraux
La condamnation pour travail dissimulé laissera une trace durable dans la vie économique de l’entreprise. Le jugement public peut être diffusé par le greffe ou les plateformes spécialisées de veille juridique, ce qui fragilise la réputation de la société. Les clients, investisseurs et partenaires financiers interprètent cette mention comme un signal de risque, souvent dissuasif dans le cadre d’un appel d’offres ou d’une levée de fonds.
L’entreprise perd également l’accès à plusieurs dispositifs d’aides publiques. Le Code du travail (article L. 8272-1) prévoit en effet la suspension ou le remboursement des exonérations et réductions de cotisations sociales lorsque l’infraction est constatée. Certaines collectivités territoriales appliquent des clauses d’exclusion automatique des marchés publics en cas de condamnation définitive.
💡 Les répercussions RH
La condamnation dégrade la cohésion sociale et installe un climat de méfiance. La relation de confiance entre les salariés et la direction s’en voit sévèrement impactée.
Le travail dissimulé chez les tiers : un risque juridique pour le donneur d’ordre
Lorsqu’une entreprise confie une mission à un prestataire ou à un sous-traitant, elle endosse une part de responsabilité juridique sur la régularité de son activité.
Le Code du travail considère que le donneur d’ordre participe indirectement au travail dissimulé s’il n’a pas vérifié la conformité sociale de ses partenaires. Cette règle place la vigilance au même niveau que la loyauté contractuelle : elle conditionne la légalité de la relation économique.
Les contrôles menés par l’Urssaf et la MSA montrent que la majorité des infractions découvertes dans la sous-traitance découlent d’un défaut de vérification ou d’un suivi incomplet des documents obligatoires.
L’obligation de vigilance vise à fermer cette brèche en imposant aux entreprises un contrôle systématique de leurs tiers, dès la signature du contrat et pendant toute sa durée.
L’obligation de vigilance : le socle juridique du contrôle des tiers
Le Code du travail (articles L. 8222-1 à L. 8222-6 et D. 8222-5) impose au donneur d’ordre et au maître d’ouvrage de vérifier la régularité de leurs sous-traitants avant la signature d’un contrat et pendant toute son exécution.
Cette vérification vise à empêcher la conclusion ou la poursuite d’un contrat avec une entreprise qui pratique le travail dissimulé ou qui n’est pas à jour de ses obligations sociales.
L’obligation s’applique à toute prestation de services, de travaux ou de fourniture dont le montant dépasse 5 000 € HT sur une année civile (article D. 8254-1). Elle concerne les relations entre entreprises établies en France mais aussi les cocontractants étrangers dès lors que la prestation s’exécute sur le territoire français.
Le donneur d’ordre ne se substitue pas à l’administration, mais il doit être en mesure de prouver qu’il a exercé les vérifications prévues par la loi. À défaut, il devient solidairement responsable du paiement des impôts, cotisations sociales et salaires dus par le sous-traitant en infraction. Cette solidarité s’étend aux amendes, pénalités et remboursements d’aides publiques attachées au contrat.
Les vérifications obligatoires pour prévenir le travail dissimulé chez les sous-traitants
Avant la signature d’un contrat et tous les six mois pendant son exécution, le donneur d’ordre doit obtenir et conserver trois documents.
- Le document d’immatriculation : extrait Kbis pour une société établie en France ou équivalent officiel pour une entreprise étrangère. Vous pouvez consulter notre article « Obligation de vigilance : Kbis ou autre justificatif d’immatriculation».
- L’attestation de vigilance URSSAF, qui certifie que le cocontractant est à jour de ses cotisations sociales au moment de l’émission. Nous en parlons en détail dans notre article « Attestation de vigilance : origine, utilité et risques».
- La liste nominative des travailleurs étrangers employés sur le territoire ou, à défaut, une attestation sur l’honneur précisant qu’aucun salarié étranger hors Espace économique européen n’intervient sur le chantier ou la mission. Pour aller plus loin, vous pouvez lire nos articles :
- « Liste Nominative des Travailleurs Étrangers (LNTE) : enjeux et défis pour les donneurs d’ordre» ;
- « Tout savoir sur l’attestation de non-emploi de travailleurs étrangers».
Pour les prestataires établis à l’étranger, la loi admet des documents équivalents traduits par un traducteur assermenté. Le donneur d’ordre reste responsable de leur authenticité et doit être capable de prouver la vérification réalisée. Nous en parlons en détail dans notre article « Fournisseurs étrangers : équivalences de documents de conformité ».
⚠️ Attention
Ces documents doivent être datés, valides et vérifiables auprès de l’organisme émetteur. Une attestation expirée, falsifiée ou dépourvue de code de vérification équivaut à une absence de vigilance.
Comment prouver la conformité et prévenir le travail dissimulé dans la chaîne de sous-traitance
Les contrôles de conformité n’ont de valeur que s’ils peuvent être dûment prouvés. Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la vigilance ne repose pas uniquement sur la collecte des documents exigés par le Code du travail (Kbis ou équivalent, attestation de vigilance et liste nominative des travailleurs étrangers/attestation de non-emploi de travailleurs étrangers). Il faut que l’entreprise puisse démontrer la réalité et la régularité du contrôle.
En effet, une entreprise qui a vérifié ses fournisseurs mais qui ne peut l’attester en cas d’audit sera condamnée. Il faut donc éviter le piège de la conformité déclarative et s’inscrire dans une conformité probatoire fondée sur des traces vérifiables, datées et opposables.
Lors d’un contrôle, les agents confrontent chaque pièce à sa source, vérifient son horodatage et rattachent l’examen à une action identifiée.
Identité du prestataire
Les contrôleurs vérifient le SIREN, la raison sociale et le représentant inscrit sur les factures et le contrat contre l’extrait officiel (Kbis ou document équivalent). Pour prouver l’identité, conservez le document officiel dans sa version récupérée auprès du registre (PDF signé ou export API) et enregistrez les métadonnées de récupération (URL, horodatage, opérateur qui a importé).
Authenticité des documents
Ils contrôlent également la présence et la validité d’un code de vérification, ou la chaîne de certification d’une signature électronique. Pour qu’un document soit opposable, il faut pouvoir démontrer que la pièce a été consultée chez l’émetteur et archiver la preuve de cette consultation (capture horodatée ou log API).
Temporalité
Les agents regardent la date d’émission et la date du contrôle. Quand la loi impose des vérifications périodiques, en l’occurrence ici semestrielles, il faut pouvoir produire l’historique des vérifications successives : version du document à chaque date, preuve de relance et preuve de réception si la pièce a été fournie par le tiers.
Traçabilité des actions
Chaque examen doit laisser une trace, avec l’identité de l’utilisateur qui a validé la pièce, l’horodatage de la consultation, la méthode d’obtention (upload fournisseur, requête API, envoi par e-mail) et la référence au lien contractuel concerné. Conservez ces journaux dans un coffre immuable pour reconstituer la chaîne d’examen en cas de contrôle.
Les erreurs qui annulent la valeur de la vigilance
Les agents rejettent les preuves qui ne permettent pas d’établir un lien daté, identifiable et vérifiable entre la pièce produite et l’entité contrôlée. Nous avons résumé dans le tableau suivant les défaillances les plus fréquentes et l’action corrective attendue.
Provigis : la plateforme qui sécurise votre obligation de vigilance face au travail dissimulé
Nous l’avons vu, l’administration renforce chaque année ses contrôles, notamment par la reconstruction des chaînes de sous-traitance afin d’identifier les donneurs d'ordre qui n'ont pas exercé leur obligation de vigilance.
Les contrôleurs vérifient la présence, l'authenticité et la temporalité des documents obligatoires. Un extrait Kbis périmé ou une attestation de vigilance non vérifiée auprès de l'Urssaf exposent l'entreprise à la solidarité financière sur les cotisations éludées, avec des montants qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros par dossier.
Depuis 2009, Provigis accompagne les directions Achats, Juridiques et Conformité des grandes entreprises dans la gestion de leurs risques tiers. Notre plateforme digitale traite quotidiennement les vérifications de milliers de fournisseurs français et étrangers. Nos équipes assurent l'embarquement des tiers, le paramétrage des workflows de validation et le suivi des taux de conformité. Chaque compte bénéficie d'un accompagnement dédié pour adapter la collecte aux règles métier et aux exigences contractuelles.
Concrètement, Provigis centralise l'ensemble des vérifications imposées par les articles L. 8222-1 à L. 8222-6 du Code du travail :
- Collecte automatisée : notre plateforme récupère les documents d'immatriculation, les attestations de vigilance Urssaf et les listes nominatives des travailleurs étrangers directement auprès de vos sous-traitants, dans une logique de mutualisation ;
- Authentification chez l'émetteur : chaque pièce est vérifiée via les API gouvernementales (Infogreffe, INSEE, Urssaf) et archivée avec horodatage, métadonnées et piste d'audit complète ;
- Contrôles semestriels automatisés : dès qu'une attestation arrive à expiration, le système relance le fournisseur et documente la démarche ;
- Journal probant : vous disposez d'un registre qui retrace chaque action de vérification, consultable lors d'un contrôle ou d'un audit.
L'intégration par API avec vos ERP, SRM et autres outils internes permet de bloquer automatiquement la création d'un bon de commande si le fournisseur n'est pas à jour. Le score de compliance affiche en temps réel le statut de chaque tiers dans votre référentiel. Réservez votre démo sans plus tarder.
